06 - Le Passage d'Agen - allée Antoine et Candide Piñol
Antoine Piñol - Brigadiste International par Idéal
Le 17 et 18 juillet 1936, la conspiration hourdie par des généraux inspirés par le fascisme italien et le nazisme allemand tente de renverser par les armes le gouvernement républicain espagnol, démocratiquement élu en février 1936. Bien que le succès complet ne soit pas au rendez-vous, les conspirateurs, aidés par Hitler, Mussolini et Salazar, prennent le contrôle de certaines villes et de leurs provinces. C’est le début d’une période longue de près de trois ans qui va ensanglanter l’Espagne. Cette guerre que le camp franquiste veut présenter comme une guerre entre frères espagnols est en réalité le prélude d’une conflagration généralisée de l’Europe en proie aux appétits de gouvernements totalitaires qui ne peuvent survivre que grâce à la rapine et au meurtre.
La République espagnole est isolée diplomatiquement et militairement par l’abandon en rase campagne des démocraties occidentales. La Grande-Bretagne et la France mettent en place une politique de non-intervention dès le 26 août 1936.
Pour répondre à l’appel à l’aide de la République espagnole, les
partis de Gauche, en Europe et ailleurs, proposent de « procéder au
recrutement, parmi les ouvriers de tous les pays, de volontaires ayant une
expérience militaire en vue de leur envoi en Espagne ». Ainsi, des
volontaires anarchistes, communistes, socialistes ou de simples républicains
comme Antoine Piñol se dirigent vers la péninsule ibérique. Le 17 octobre 1936,
Staline se prononce enfin en faveur d’un soutien à l’Espagne et le dirigeant
socialiste Largo Caballero, chef du gouvernement de la République espagnole
depuis le 4 septembre 1936, autorise le 22 octobre, la formation des Brigades Internationales
en soutien d’el Ejército Popular de la República. Les
volontaires antifascistes vont arriver de cinquante-trois pays différents. Ce
sont les partis communistes et les syndicats
ouvriers qui se mobilisent en priorité pour recruter.
Sous le contrôle du Komintern (Troisième Internationale Communiste), un bureau parisien est mis sur pied pour procéder au recrutement des volontaires. Arrivés par route, par chemin de fer ou par mer, les premiers combattants sont affectés à la défense de Madrid sous le feu des rebelles franquistes. Parmi eux, il y a Antoine Piñol, un jeune catalan de 21 ans, immigré en France. Il vient de Villeneuve-sur-Lot.
L’engagement pour la République espagnole d’Antoine Piñol
Né à Palamós, dans la province de Gérone, en mai
1915, Antoine Piñol perd son père en 1921, mort au cours de son service
militaire au Maroc espagnol. Les temps sont durs pour sa jeune mère dans
l’impossibilité de subvenir aux besoins de son fils. Le royaume d’Espagne vit
en permanence une grave crise sociale et économique. Sous le coup de deux restaurations
bourboniennes depuis le début du XIXe siècle, le pays n’a jamais pu, voulu, ou
su prendre le virage des révolutions industrielles qu’ont connu les pays du
Nord de l’Europe. Il est donc mal préparé pour affronter les défis qui
l’attendent. Sa neutralité lors de la Première Guerre Mondiale lui procure une
légère embellie due à la forte demande de produits vivriers de la part des pays
belligérants mais elle ne profite qu’aux négociants et aux trafiquants
espagnols. La population a du mal à trouver de l’huile, des pommes de terre, du
blé, du charbon… Ayant dû faire face à une grave crise sociale et économique en
1917, la situation empire pour l’Espagne quand se termine le conflit mondial. Cet
arrêt aggrave les conditions de survie, car le prix de vente de certains
produits est poussé à la hausse.
Sans solution viable, la grand-mère d’Antoine décide de partir pour la France, accompagnée de son petit-fils. Elle croit que le pays des Libertés lui donnera la chance d’un avenir meilleur. Arrivés à Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne, sans papiers, la grand-mère et Antoine se font le plus discrets possible pour éviter les railleries habituelles que subissent généralement les étrangers. Antoine parle catalan avec sa grand-mère et apprend le français à l’école. Dès l’âge de dix ans, peut-être parce qu’Il ne montre pas de grandes dispositions pour les études mais plus sûrement parce que l’argent manque à la maison, Antoine prend le chemin d’un atelier pour devenir mécanicien.
Déjà, son tempérament bouillonnant le conduit à fouler les terrains de rugby et à pratiquer la lutte gréco-romaine. Il excelle dans ce sport de combat puisqu’il atteint la finale du championnat de France junior à Paris.
L’éloignement de la Catalogne n’empêche pas la grand-mère de cultiver chez son petit-fils l’amour des valeurs incarnées par la jeune République espagnole. Surtout que cette dernière accorde à Barcelone et sa région le statut d’autonomie en 1931. Quand les généraux félons se soulèvent pour abattre le régime démocratiquement élu, Antoine entend sa grand-mère dire que les choses ne vont pas bien dans son pays natal. Le jeune homme, pétri d’idéal républicain et considérant que la République espagnole court un grave danger, se sent immédiatement concerné. Sous le regard fier et approbateur de sa grand-mère, Antoine décide de rejoindre les volontaires étrangers qui partent combattre aux côtés des Républicains espagnols.
Pour prendre le chemin de l’Espagne, Antoine Piñol gagne d’abord le port de Bordeaux en septembre 1936. Là, il pense trouver une embarcation en partance pour la péninsule ibérique. Mais aucun navire n’appareille vers cette destination. Alors, il se souvient qu’il a un oncle maternel à Perpignan, autre voie d’accès à l’Espagne. Après avoir rendu visite à cet oncle, le voilà sur le quai de la gare de Perpignan, où il peut monter à bord d’un train en direction de la frontière par Cerbère puis Port-Bou.
Passée la frontière, des Italiens, des Belges, des Français montent à bord du train. Tout le long du voyage qui les emmène vers Albacete, Antoine a le loisir de discuter avec eux. Il constate qu’ils sont là pour les mêmes raisons que lui : défendre par idéalisme la République espagnole, assaillie par les rebelles franquistes, inféodés au fascisme italien et au nazisme allemand. Après être descendu du train en gare d’Albacete, siège des Brigades Internationales dirigées par le Français André Marty, Antoine choisit de combattre avec les Italiens. Les volontaires étrangers sont réunis dans les arènes d’Albacete et les 500 Italiens, avec Antoine, partent pour Madrid à bord de camions. Ce faisant, le jeune homme intègre le Bataillon Garibaldi.
Les antifascistes italiens et la République espagnole
La Gauche italienne, en exil ou dans la clandestinité dans l’Italie mussolinienne, est enthousiaste quand elle apprend qu’en Espagne le mouvement ouvrier et paysan s’oppose aux rebelles fascistes. Ce mouvement populaire vient à peine de conquérir démocratiquement le pouvoir qu’il doit aussitôt faire face aux forces ultra conservatrices décidées à le détruire physiquement. Plusieurs militants italiens se trouvent en Espagne au moment du coup de force manqué de Mola et de Franco. Parmi eux, il y a le socialiste Fernando De Rosa, qui tombe lors de combats, le 19 septembre 1936, à la tête du bataillon « Octubre ». De son côté, Carlo Rosselli constitue une unité militaire autonome avec des émigrés, dès le mois d’août 36. Sa colonne italienne est apparentée au syndicalisme anarchiste.
Dès le début de la Guerre d’Espagne, les socialistes et les communistes italiens s’alignent d'abord sur les directives du Front Populaire français. Ce dernier, empêtré dans sa politique de non-intervention, déconseille l'envoi de volontaires. Alors, les deux partis italiens commencent à recueillir des fonds et des produits pharmaceutiques à destination de la République espagnole. Parallèlement, ils envoient en Espagne des techniciens et des experts militaires. Quand l'espoir d'une neutralisation rapide de la sédition disparait alors que l'engagement des puissances fascistes apparaît au grand jour, faisant pencher la balance du côté des franquistes, leur attitude change.
Ils préparent la formation d'une force constituée de volontaires qu’ils souhaitent incorporer dans les milices républicaines espagnoles. Derrière cet objectif, le but est le renversement des dictatures fascistes européennes : « Aujourd’hui en Espagne, demain en Italie » dit le dirigeant communiste italien Togliatti. L’anéantissement définitif des fascismes est considéré comme une condition préalable à l'établissement d'une société organisée sur une base plus libre et plus égalitaire.
Entre temps, l’avocat italien Randolfo Pacciardi, ancien combattant de la Première Guerre Mondiale, émet l'idée de former un corps de volontaires qui irait au secours de la République espagnole menacée. Il le conçoit comme une « légion italienne » absolument non partisane, organisée sur le modèle des Garibaldini qui en 1897-1898 avaient combattu en Grèce contre les Turcs ou de ceux qui rejoignirent la France en 1914, avant que l'Italie n'entre en guerre à son tour aux côtés des alliés. Il obtient gain de cause, et le 26 octobre 1936, il signe un accord, à Paris, entérinant la création d'une légion antifasciste italienne sous le parrainage politique des partis socialistes, communistes et républicains, assistés des organisations membres du comité italien pour l'Espagne.
Pacciardi est nommé major et prend le commandement du bataillon. Il est secondé par les commissaires politiques communistes Antonio Roasio, Luigi Longo et le socialiste Amedeo Azzi. Le bataillon fait partie de la XIIe Brigade Internationale aux côtés du bataillon franco-belge André Marty et de l'allemand Thälmann. Le bataillon est composé de quatre compagnies très majoritairement italiennes et d’une cinquième où combattent des éléments mixtes, espagnols et italiens. Il est flanqué de deux groupes d'assaut : Arditi (les Audacieux, chargés des opérations spéciales) dont fait partie Antoine Piñol et Il Terribli (les Terribles). En décembre 1936, le groupe Arditi absorbe les Terribli.
Les combats contre les fascistes autour de Madrid
Quatre mois après la tentative de coup d’Etat des 17 et 18
juillet, les franquistes n’ont toujours pas réussi à s’emparer de Madrid. La
conquête de la capitale espagnole est confiée au général félon Mola,
l’initiateur du soulèvement militaire. Il planifie un blocus de la ville pour
l’isoler du reste du pays afin de porter un coup décisif à la République. Cette
stratégie d’envergure ne lui réussit pas, peut-être parce qu’il fait de mauvais
choix tactiques mais certainement parce que le futur dictateur Franco pense
déjà au coup d’après. En laissant son concurrent Mola s’enliser dans le
bourbier madrilène, Franco cherche à le discréditer.
Antoine Piñol et ses compagnons arrivent dans un couvent
désaffecté, proche de Madrid. Dans cette caserne improvisée, Antoine reçoit sa
première formation militaire, expédiée en quelques jours et découvre son chef,
Guido Picelli. Ancien Combattant de la Première Guerre Mondiale et ancien
député socialiste, avant la prise de pouvoir par Mussolini, Picelli crée dans
sa ville de Parme les Arditi del Popolo et, en 1922, combat les armes à
la main contre les escadrons mussoliniens sur les barricades antifascistes de
Parme. En 1924, il est élu député communiste puis condamné à cinq ans d’exil
qui vont le conduire en France puis en Belgique et enfin en URSS. En juillet 1936, la Guerre d’Espagne éclate et Picelli demande à
être autorisé à quitter l'Union soviétique pour aller combattre le franquisme.
Il passe par Paris, puis se rend à Barcelone où il prend contact avec le POUM,
un parti trotskiste. A la tête de la Colona Picelli, composée
d’anarchistes, il rejoint Albacete pour être intégré au Bataillon Garibaldi.
Installés
dans une nouvelle caserne, dans le parc du Prado, Antoine et ses compagnons
reçoivent leur premier uniforme. Bien que les combats soient très proches, mais
parce que l’organisation n’est pas parfaite, les volontaires ont du temps pour
visiter la capitale espagnole. Le moral est bon et l’entente est au
rendez-vous, d’autant que de nouvelles recrues arrivent sans cesse.
Du 11 au 15 novembre 1936, le
bataillon Garibaldi reçoit le baptême du feu au Cerro de los Angeles (Cerro
Rojo). Mal équipée et mal entrainée, la journée du 12 est la plus terrible pour
la XIIe Brigade Internationale car elle subit d’innombrables pertes, en partie
compensées par les continuelles arrivées de volontaires internationaux. Antoine
Piñol raconte[i] :
« Nous montons à pied, essuyant des tirs, quand je ressens une vive
douleur à la cuisse. Une balle m’a touché. Blessé, je redescends lentement
avant le lever du jour. Le service d’ambulance me prend en charge. Epuisé, je
suis conduit à un hôpital madrilène. Mais je regagne mon bataillon avant la fin
du mois ! »
Du 18 au 26 novembre 1936, le bataillon
est engagé dans les combats qui opposent les Républicains aux franquistes qui
tentent de prendre la capitale par l’Ouest en essayant de s’emparer d’abord de
la Cité Universitaire. Après avoir perdu la Casa de Campo, le bataillon se
replie avec les forces Républicaines dans la Cité Universitaire pour y
poursuivre une résistance acharnée. La combativité des Républicains permet de
stabiliser le front ouest pratiquement jusqu’à la fin de la guerre. Antoine
Piñol témoigne[ii] : « L’Université,
c’est le rempart qui permet à Madrid de tenir. L’enjeu est crucial. Nous
avançons prudemment sur un chemin, sous les arbres. Je suis en tête avec un
autre gars, exposés à l’artillerie d’en face. Heureusement, nous avons enroulé
des couvertures autour de nos corps, cela nous protège un peu. Mais ça canarde.
Et pas de n’importe où. Ce sont les arbres. Ou plutôt les soldats marocains –
les Maures comme on les appelle – cachés dedans, qui nous tirent dessus comme
sur des lapins ! alors on sort les mitrailleuses, et les types tombent
comme des fruits trop mûrs ».
Du 20 au 23 décembre 1936, le
bataillon est envoyé en soutien à Boadilla del Monte, pour s’opposer à la
deuxième tentative des fascistes de s’emparer de la route de la Corogne.
Du 31 décembre 1936 au 7 janvier
1937, après les échecs successifs des franquistes dans la conquête de
Madrid en novembre et dans les opérations ultérieures sur Pozuelo et Boadilla
en décembre, les Républicain tentent de surprendre l’ennemi en l’attaquant loin
de Madrid. Il s'agit de prendre trois villes au Nord de Guadalajara : Algora,
Mirabueno et Almadrones. Le but est d’atteindre Siguënza et percer le front
relativement peu garni des franquistes.
C’est la XIIe Brigade Internationale qui est chargée de
l’opération, sous le commandement de Randolfo Pacciardi. Guido Picelli est à la
tête du bataillon Garibaldi. L'attaque débute à l'aube du 1er janvier
1937. Trois bataillons internationaux sont déployés depuis la région de Las
Inviernas : les Franco-Belges sont positionnés face à Algora, les Garibaldiens
se concentrent sur Mirabueno et les Polonais, avec l'aide de la brigade
espagnole du bataillon, doivent prendre Almadrones.
Le 1er janvier 1937, devant Mirabueno (province de
Guadalajara), Picelli prend le commandement du bataillon Garibaldi, et le 2
janvier, à la tête de ses hommes, il lance une attaque éclair, brise les lignes
fascistes, pénètre dans Mirabueno, fait prisonniers des dizaines de franquistes
et libère une grande partie de la route qui relie Madrid à Saragosse.
Antoine Piñol relate la prise de Mirabueno[iii] : « Un autre jour, le rassemblement est sonné de très bonne heure. Nous devons monter dans les camions. Le but : reprendre un village, Mirabueno, qui surplombe la route nationale [Madrid-Saragosse] à une centaine de kilomètres de Madrid.
Sur place, les Arditi passent à l'action. Par six, nous atteignons les murs de la cité, puis la place de l'église. Il y a des tirs de toute part. Armé de mon fusil, je pénètre dans l'église, j'aperçois la porte qui mène au clocher, ouverte. Je monte et domine bientôt la place du village. Je me mets en position, je vise, j'appuie sur la gâchette... Le coup ne part pas ! La balle reste coincée dans la culasse, et pas de baguette pour la repousser. Satanés fusils ! De vraies antiquités, qui ont déjà servi au Mexique pendant la révolution de Zapata, en 1910. Désarmé ! Je suis désarmé ! Soudain, j'entends des pas à l'Intérieur de l'église. Ils se rapprochent... Mon cœur bat la chamade, je suis perdu. Pas d'arme, pas de grenades non plus, car notre départ a été si rapide que j'ai oublié de les prendre. Le clocher est haut, impossible de m'enfuir par l'extérieur. La seule solution : guetter l'escalier et me préparer à me jeter cinq mètres plus bas sur le premier type qui apparaîtra. Excellent lutteur, j'ai une chance de m'en sortir. J'en suis là de mes réflexions quand les bruits de pas cessent... Puis reprennent dans l'autre sens ! Le visiteur a fait demi-tour. Je respire ! Bientôt, je peux descendre à mon tour, vigilant mais incroyablement soulagé. »
Voici comment le brigadiste italien Giovanni Pesce raconte l’assaut de Mirabueno :
« La nuit du 29 décembre 1936 s‘avance. Maintenant, tous les Garibaldiens sont en armes. La 2e compagnie est cantonnée dans une école (dans la ville de Las Inviernas). En dépit de l'hiver, le climat est doux, il ressemble au printemps.
Au petit matin (le 1er janvier) nous partons et après 20 kilomètres, nous descendons des camions pour continuer à pied. La route Madrid-Saragosse est occupée par les forces fascistes. Nous avançons lentement en observant le terrain. Le bruit des deux chars qui nous précèdent rompt le silence. Dans la forêt, les chars couchent les arbres, nous ouvrant la voie. Picelli observe les positions fascistes avec des jumelles. La cavalerie tente de prendre contact avec l'ennemi. Nous stationnons, le temps de préparer et avaler le petit déjeuner. Le commandant de compagnie et les commissaires sont convoqués par le commandement. Après une présentation détaillée, le commandement répartit les tâches de chaque unité.
L'avance commence. Nous ne rencontrons pas de résistance, toute surprise est à craindre. Picelli ordonne d'envoyer de petites patrouilles à l’avant… Nous progressons à travers les champs séparés par des murets, ce qui nous permet d'avancer rapidement sans être vus par l'ennemi… A un moment Giordano semble entendre un bruit venant de derrière un mur. Nous donnons l'alarme. Des ombres se sauvent et disparaissent. Nous sommes en position de tir. On court après l'ennemi pour ne pas lui laisser le temps de se préparer. Après environ 300 mètres nous voyons d'autres ombres bouger. Pendant que nous plaçons la mitrailleuse, l'ennemi tire les premières rafales. Nos fusils mitrailleurs nous protègent à mesure que nous avançons. Les fascistes tirent dans tous les sens mais ils reculent, abandonnant armes et munitions. Les tirs de nos chars frappent avec précision les défenses ennemies.
Arrivés dans les premières maisons
de Mirabueno, nous trouvons une plus grande résistance. Il y a des fascistes en
embuscade qui nous tirent dessus. On voit Picelli courir d'un bout à l'autre,
donner des ordres et des conseils sans cesser de tirer... Les fascistes s'enfuient
en désordre. Nous avons fait des prisonniers en occupant Mirabueno…. Nous capturons
trois ambulances et plusieurs voitures, dont une chargée de paquets cadeaux
envoyés par Franco à ses troupes... »
Mais trois jours plus tard, le 5 janvier près d’Algora, Picelli meurt,
atteint d'une balle... « dans le dos à hauteur du cœur ». Giovanni Pesce
évoque la mort de Guido Picelli en ces termes : « Les Garibaldiens
se dirigent vers leurs cibles. Picelli est à leur tête. Sa présence leur donne
du courage. Nous lui disons de ne pas trop s'exposer, de ne pas toujours se
mettre en avant. Nous savons qu’il ne nous écoutera pas. Et le voilà en tête
sous des tirs intenses. Les Polonais se battent furieusement, mais les
fascistes résistent ; il semble impossible d'occuper la colline, une position
clé pour conserver Algora. Le combat continue avec plus de violence et dans la
fureur de la bataille ils nous annoncent la triste nouvelle : Guido Picelli est
tombé comme un héros à la tête de ses hommes... »
Antoine Piñol donne sa version sur la mort de Picelli au Cerro San Cristobal (dans la Serranía de Guadalajara)[iv] : « La Ermita de San Cristobal est plantée sur une colline infestée de fascistes. Nous attendons à l’abri dans une tranchée. Alors que le signal de l’assaut n’a pas été donné, Picelli sort la tête pour regarder. Un coup de feu claque. Tué net. C’est la stupeur. Sous le choc, nous regagnons notre caserne ».
Du 10 au 26 janvier 1937, dans le secteur des villages de Majadahonda
et de Boadilla del Monte, les garibaldiens participent à la tentative
républicaine de reprendre le contrôle de la route de la Corogne. Puis ils
montent en deuxième ligne dans les combats qui se déroulent dans la Sierra
de l’Escorial.
Du 10 au 26 février 1937, le bataillon Garibaldi est engagé à Arganda del Rey et du 26 au 27 février 1937 à Morata de Tajuña.
Du 9 au 19 mars 1937, à Guadalajara, la XIIe Brigade
Internationale, dont les garibaldiens, vient renforcer le front républicain qui
doit faire face à une attaque des fascistes italiens. Depuis la veille, ils essaient
de s’emparer de la zone au Nord de Madrid. Au début de la bataille, les
Républicains sont obligés de céder du terrain mais leur contre-offensive a lieu à partir du 15 mars. Le 18, les Républicains poursuivent
leur avance dans une contre-attaque générale. Les fascistes italiens se retirent
pour éviter d'être encerclés après avoir perdu la majeure partie de leur
matériel. Entre le 19 et le 23 mars, les Républicains récupèrent le territoire
perdu et les fascistes sont revenus à leurs positions antérieures.
La combativité des garibaldiens de la XIIe Brigade Internationale
est d’une importance capitale lors de la contre-attaque républicaine.
Guadalajara retentit comme une victoire significative pour le camp Républicain.
Du 3 au 6 avril 1937, les garibaldiens sont de nouveau engagés à Morata de Tajuña sur le front de la rivière Jarama. Depuis le mois de février 1937, les franquistes tentent de couper les routes qui relient Madrid à Barcelone et Valence. Cette coupure leur permettrait de boucler l’encerclement de la capitale. Les Républicains, grâce à leur abnégation, parviennent à stabiliser le front et sauvent Madrid.
Du 11 au 27 avril 1937, le bataillon Garibaldi est de retour dans
le secteur de la Casa de Campo et à la Cité Universitaire où se déroule une
guerre de positions qui va se poursuivre jusqu’au 28 mars 1939, trois jours
avant la chute de la République espagnole, à la suite de la trahison du général
Casado.
Tout au long de ces combats, les pertes humaines de la XIIe Brigade Internationale ayant été trop importantes, une réorganisation de ses unités s’impose. Le 31 avril 1937, le bataillon Garibaldi donne son nom à la nouvelle XIIe Brigade qui devient la XIIe Brigade Internationale Garibaldi.
En mai-juin 1937, la Brigade Garibaldi, avec d'autres Brigades Internationales, est envoyée sur le front de Huesca (Haut Aragon), dans le but de reprendre la ville aux fascistes. Mais l’usure des combats et un mauvais équipement ne lui donne pas l’élan espéré et l’opération se termine par un échec. Voici le témoignage d’Antoine Piñol : « Après les repérages vient l'assaut le 16 mai 1937. Les chars ouvrent la voie sur Huesca. Ils doivent arracher les barbelés et ouvrir le passage aux premiers Arditi. Notre section, jusqu'alors en deuxième ligne, devance tout le bataillon Garibaldi. Les tirs viennent de partout : un feu rasant, à vingt centimètres du sol. Impossible de se coucher pour se protéger. Ceux qui le font prennent une balle en pleine figure. Ceux qui restent debout sont touchés aux jambes. Le résultat ? Un désastre ! Au bout de cent mètres, le sol est jonché de cadavres et de blessés. Nous perdons un commandant de bataillon, plusieurs capitaines. En tout, nous déplorons une cinquantaine de tués, des centaines de blessés. J'en fais partie : une balle me traverse la cheville. Elle a raclé l'os, mais le tendon n'est pas sectionné. Je m'en sors bien. Je suis envoyé à l'hôpital de Benicàsim (province de Castellón de la Plana). »
En juillet 1937, la brigade Garibaldi est rappelée à nouveau sur le front de Madrid pour intervenir dans l'offensive de Brunete. D’abord placée en réserve, elle participe, le 10 juillet, à la prise de Villanueva del Pardillo. Malgré le succès des troupes républicaines au sol, les forces aériennes républicaines perdent l’initiative au profit de la Légion Condor nazie. Cette dernière vient d’être dotée des derniers chasseurs Messerschmitt et bombardiers Heinkel qui font la différence. Les pertes humaines parmi les Brigades Internationales sont considérables et les tentatives répétées d'occupation de Villafranca del Castillo aboutissent au retrait de la XIIe Brigade.
En août et septembre 1937, la XIIe Brigade Garibaldi est profondément réorganisée à la suite de sa participation à l’offensive Républicaine sur Saragosse.
En février 1938, la Brigade est en Estrémadure. Elle lance une attaque nocturne dans la région de la Sierra Quemada. Elle atteint les sommets mais doit finalement battre en retraite après avoir perdu 1 134 hommes.
Début juillet 1938, lors de la préparation de la bataille de l'Èbre, la Brigade Garibaldi est positionnée sur la rive gauche du fleuve. Le 27 juillet, l'ordre lui est donné de traverser l’Ebre pour se mettre en réserve jusqu'au 14 août. Ce jour-là, elle est envoyée pour relever la XIe Division dans la Sierra de Pàndols.
Antoine raconte : « Nous prenons position sur une montagne, la Sierra de Pàndols. La nuit, nous descendons attaquer les soldats marocains de Franco. Je perds des hommes à chaque fois. La journée, nous nous abritons comme nous pouvons de la pluie, des bombes. Tout n'est que pierre et caillasse, impossible de bien se protéger. En septembre 1938, après des semaines de combats, je suis blessé pour la troisième fois. Une bille en acier se loge à la jointure de la hanche. Je suis évacué vers Barcelone, à l'hôpital. Mais, là, pas le moindre anesthésiant. La souffrance est insoutenable. À côté de moi, dans cet hôpital démuni, il y a quelques jeunes types qui sont au plus mal. J'ignore depuis quand ils sont là, et j'espère juste ne pas subir leur sort. L'un a un trou dans la cuisse et une simple gaze posée dessus. C'est infecté, la gangrène le ronge et il n'y a aucun médicament. Une horreur comme en 1914-1918. »
Deux jours plus tard, la Brigade contre-attaque sur le Puig del Águila, dont elle parvient à atteindre le sommet à la tombée de la nuit.
Au mois de septembre 1938, les fascistes repoussent la Brigade vers son point de départ, le 14 août précédent sur la rive droite de l’Ebre. A cette occasion, elle subit de nombreuses pertes.
Le retrait des Brigades Internationales
Dès sa prise de fonction en juin 1937, le chef du gouvernement Républicain, Juan Negrín, propose une réconciliation des Espagnols en élaborant un programme de reconstruction de la nation espagnole dénommé « Les Treize Points ». Franco, vainqueur en Aragon, rejette immédiatement ce plan. De leur côté, les puissances occidentales ne donnent pas suite. Elles préfèrent négocier avec les fascistes (Accords de Munich), et la Russie interprète cette proposition comme un aveu de faiblesse. Confronté à une situation sans solution militaire ni politique, Juan Negrin tente un dernier coup de poker : le renvoi des Brigades Internationales en échange du retrait des Allemands, des Italiens et des Marocains sous le contrôle de la Société des Nations. Conformément à l'engagement pris par Negrín, le 21 septembre 1938, devant la SDN, les Brigades Internationales sont retirées du front. Dans le camp franquiste, les forces fascistes étrangères continuent à occuper le territoire espagnol. Pour la XIIe Brigade, le retrait s’effectue dans la nuit du 24 au 25 septembre 1938.
Pour autant, tous les brigadistes ne prennent par le chemin du retour vers la frontière. En septembre 1938, Antoine Piñol est encore sur un lit d’hôpital à Barcelone. Après deux semaines de convalescence, il regagne le front de l’Aragon où la situation ne fait qu’empirer. Il n’y a plus de discipline, les unités combattantes sont désorganisées. La machine de guerre fasciste est à son apogée. Antoine et ses compagnons, sous le feu des rebelles, reculent en direction de Barcelone. Arrivés à Martorell, affamés, épuisés, constamment attaqués, ils prennent un peu de repos pour pouvoir récupérer des forces. Lors d’un bombardement, Piñol est violemment projeté par l’impact d’un obus, tombé tout près de lui : sa carotide est atteinte. Grâce à la pose d’un garrot improvisé, l’hémorragie peut être arrêtée. Le 24 janvier 1939, Antoine Piñol est opéré dans un hôpital de Barcelone.
La débâcle Républicaine
Au moment où Barcelone est sur le point de tomber, les brigadistes de l’ancienne XIIe Brigade Internationale, encore en attente de départ de la Catalogne, reconstituent un embryon de XIIe Brigade Internationale. Ils se replient le long du versant Nord-Ouest du Montseny et tentent de résister à la pression des fascistes à Llagostera. Puis le repli se poursuit le long du littoral pour finalement gagner la frontière française.
De son côté, Antoine Piñol est toujours hospitalisé et les franquistes sont déjà dans les faubourgs de la capitale catalane. Laissons Antoine décrire la manière dont il gagne la frontière française[v] : « Je suis opéré le 24 janvier 1939. La date n'est pas anodine : le surlendemain, les franquistes sont dans Barcelone. Sur mon lit, je suis réveillé par un lieutenant originaire des Asturies, lui-même blessé à la jambe. « Dépêchez-vous, les fascistes sont là !» Barcelone tombe. Le lieutenant m'aide à m'habiller, et nous descendons dans la rue. La célèbre avenue des Ramblas est déserte, pas un chat, même pas le chant des oiseaux... Je suis à bout, affalé contre un mur, incapable de faire quoi que ce soit. Une voiture officielle passe près de nous. Mon compagnon l'arrête, et à ma grande surprise, met son revolver sous le nez du chauffeur pour l'obliger à nous prendre ! Dans la voiture, amorphe, j'assiste au spectacle de milliers de Catalans marchant dans la même direction que nous : la France, encore si loin.
Nous atteignons Gérone le 27 dans la soirée. C'est la région où je suis né, mais je ne suis pas en état d'apprécier. Je suis exténué : opéré trois jours plus tôt, je n'ai rien mangé ni bu depuis des heures. Mon collègue, plus vaillant, a repéré un groupe d'hommes qui allume des feux pour se chauffer. À cent mètres d'eux, des mulets. Il en détache deux, me soulève, m'assied dessus... Nous voilà repartis au milieu de la foule. Nous atteignons la frontière entre mer et montagne, à Port-Bou. Les gardes français, me voyant blessé, me laissent passer après avoir confisqué mon revolver. À la gare de marchandises, mon compagnon me pose sur un quai. Je suis déshydraté, affamé, épuisé. Je m'endors là... »
La France de Daladier punit les Brigadistes
Une ambulance emmène Antoine Piñol à l’hôpital de Perpignan, où il peut se rétablir avant de regagner Villeneuve-sur-Lot. Là, il retrouve sa grand-mère, Candide-Denise, la fiancée qu’il a quittée il y a plus de deux ans et demi, et son travail de mécanicien ajusteur. Mais le répit est de courte durée.
Le gouvernement radical-socialiste de Daladier considère que tous ceux qui ont franchi la frontière franco-espagnole au moment de la Retirada, sont de dangereux révolutionnaires. S’ils ont échoué à imposer un régime bolchevique en Espagne, ils peuvent encore nuire à la France en important des idées qui risquent de porter atteinte à la Démocratie. Le ministre Sarraut s’empresse de faire construire des dizaines de camps de concentration, selon la dénomination officielle, afin d’y incarcérer cette peste rouge.
Antoine Piñol n’échappe pas au coup de filet organisé par les autorités françaises. Au mois d’avril 1939, il voit débarquer, chez lui, trois gendarmes qui le jettent dans un fourgon en direction du camp de concentration de Septfonds, près de Caussade (Tarn-et-Garonne). C’est un immense camp au milieu de nulle part. A terme, 15 000 à 20 000 Espagnols y seront incarcérés. Quand Antoine Piñol arrive là, le terrain est nu, pas de baraques pour se protéger des intempéries qui déversent d’abondantes précipitations. Lui et ses compagnons de misère s’acharnent sur les ceps de vignes pour les transformer en bois de chauffage. Ils couchent à même le sol, il n’y a pas d’hygiène et la nourriture ? Peut-on appeler cela de la nourriture ?
Fin avril, les premières baraques sont construites, un semblant de sanitaires est installé, mais pour le reste, heureusement qu’il y a la solidarité extérieure. Antoine a de la chance : il peut recevoir la visite régulière de sa fiancée Candide-Denise qui lui apporte de la nourriture et de quoi se soigner. Six mois plus tard, cette dernière organise un extraordinaire stratagème pour libérer Antoine. Elle fait glisser un faux ordre de libération dans une pile de documents que le préfet de Lot-et-Garonne signe sans sourciller. Antoine est enfin libre, il revient à Villeneuve-sur-Lot, où il retrouve un emploi et peut enfin épouser Candide-Denise.
En France, Antoine Piñol poursuit son combat contre les mêmes ennemis : le nazisme et le fascisme
Ce que Juan Negrín avait pronostiqué et si longtemps espéré finit par se produire : la Seconde Guerre Mondiale commence. Le 1er septembre 1939, la Pologne est envahie par l’Allemagne nazie. En vertu du traité qui les lie à Varsovie, la Grande-Bretagne et la France sont contraintes de déclarer la guerre à Hitler le 3 septembre, sans intervenir militairement.
Le 10 mai 1940, un déluge de feu s’abat sur l’Europe occidentale. Hitler met à genoux la France et Pétain, un ami de Franco, prend le pouvoir en France. Après avoir caracolé sur tous les terrains de bataille européens, Hitler tombe sur un os en janvier-février 1943 : il n’est plus invincible, le 2 février 1943, les nazis capitulent dans Stalingrad. C’est le tournant de la guerre.
Plus que jamais, l’Allemagne a besoin de main d’œuvre pour remplacer ses forces vives mobilisées sur tous les fronts. Les nazis exigent que 500 000 travailleurs étrangers soient présents sur le sol allemand avant la mi-mars. Dès le 16 février 43, les pétainistes inventent le Service du Travail Obligatoire (STO) pour répondre à l’injonction de leur allié.
Bien que le STO ne concerne que les personnes nées entre 1920 et 1922, Antoine Piñol a la désagréable surprise de recevoir une convocation pour aller travailler en Allemagne. Grâce au consulat d’Espagne à Agen, il réussit à faire valoir sa nationalité espagnole pour pouvoir échapper à la réquisition. Mais deux précautions valent mieux qu’une seule. Avec ses compagnons de travail espagnols, il prend le maquis et crée un bataillon de Résistants espagnols.
Antoine Piñol poursuit le combat antifasciste
Rejoint par son épouse Candide-Denise, Antoine reprend le même combat qu’il a entamé en septembre 1936 : ne pas permettre au fascisme d’annihiler les valeurs humanistes et démocratiques. Avec son groupe, il rejoint les Résistants du Groupe Franc 13 (GF13) du capitaine Henri Richard avec lequel il achève la libération du Lot-et-Garonne. Après avoir chassé les nazis du département, il poursuit la lutte contre l’Allemand à la Pointe de Graves. Retranchés dans cette poche de l’Atlantique, les nazis n’en sont chassés qu’à la veille de la capitulation allemande, le 8 mai 1945.
Agé de 30 ans, la paix revenue, Antoine peut enfin tirer le bilan de son engagement pour la Liberté : 9 années de souffrances et de privations, mais avec le sentiment du devoir accompli.

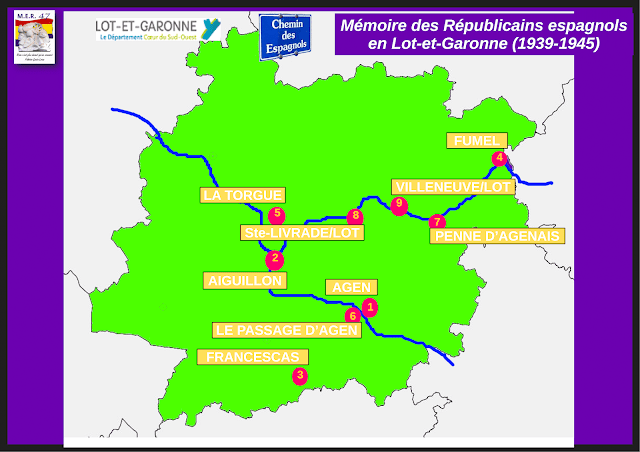
Commentaires
Enregistrer un commentaire