09-3 - Villeneuve - terrain de football "Eduardo Frias"
Un Républicain espagnol à Mauthausen
Originaire de l’Hospitalet, près de Barcelone, Eduardo Frías a 13 ans lorsqu’éclate la Guerre d’Espagne, le 18 juillet 1936, à la suite du coup d’état manqué perpétré par des généraux félons. Il travaille comme fondeur pour l’armée républicaine dès 1937. La guerre lui prend son père et au moment de la Retirada, il se retrouve seul, loin du reste de sa famille. Arrivé en France, il est interné dans les camps de concentration d’Argelès-sur-Mer et de Saint-Cyprien. Malgré les souffrances endurées dans ces camps, son inconscience du danger et la force de sa jeunesse lui permettent de réussir son évasion à la nage en contournant les barbelés disposés dans la mer Méditerranée pour empêcher les fuites.
Il se
retrouve dans le centre de la France, où il travaille dans une Compagnie
de Travailleurs Etrangers (CTE). Après la débâcle de 1940, il rentre dans la
clandestinité et est fait prisonnier par les Allemands. Ils le déportent au camp de concentration de
Mauthausen, en Autriche, où il participe à l’extension. Pendant sa longue captivité
de cinq ans, il extrait des pierres dans les carrières de granit. Il parvient à survivre, en
dépit du travail exténuant, des humiliations morales et physiques et d’une nourriture
réduite au tiers de ses besoins. Libéré en 1945, par l’armée américaine, il
arrive à localiser sa famille dans le Lot-et-Garonne.
Chez Eduardo Frías, La passion du ballon rond, qu’il a acquise dans les rues de l’Hospitalet, ne s’est pas éteinte. En témoigne sa participation à la fondation du club de football villeneuvois dont le terrain porte aujourd’hui son nom.
La sortie des camps de concentration français
En avril 1939, environ
500 000 réfugiés espagnols sont entassés dans des camps de concentration, majoritairement
situés dans le Roussillon (Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien-sur-Mer, Rivesaltes…).
Les conditions dans lesquelles ils sont obligés de survivre sont indignes. La
maladie et la mort font de nombreuses victimes.
Le gouvernement français les considère comme un poids économique insupportable et surtout comme un danger politique majeur : ce sont des « rouges », des ennemis de la démocratie. Il va tout faire pour se débarrasser du problème.
Les familles sont séparées. Les femmes et les enfants sont envoyés dans des centres d’accueil improvisés, répartis sur une grande partie du territoire français. Les hommes sont dispersés dans de nouveaux camps de concentration principalement implantés dans le Sud-Ouest (Agde, Bram, Gurs, Le-Vernet-d ’Ariège, Septfonds…). Pour échapper à l’enfermement et retrouver leur famille, ils doivent choisir entre plusieurs options :
1. Emigrer vers un autre pays, souvent en Amérique latine voire l’URSS ;
2. Repartir en Espagne de manière forcée ou volontaire ;
3. Se procurer un contrat de travail à l’extérieur des camps ;
4. Intégrer les Compagnies de Travailleurs Etrangers (CTE) ou signer un engagement militaire.
A la suite de ce « tri », environ 170 000 personnes demeurent encore en France métropolitaine en mai 1940.
Le gouvernement radical-socialiste d’Edouard Daladier voit l’opportunité d’employer cette main-d’œuvre souvent qualifiée, dans des compagnies de renforcement destinées à travailler dans :
· Des entreprises sous-traitantes des armées ;
· L’agriculture ;
· La réalisation de projets comme la construction de barrages hydroélectriques.
La déclaration de guerre de la
France à l’Allemagne, le 3 septembre 1939, mobilise la main-d’œuvre française.
La création de ce que l’on appellera Compagnies de Travailleurs Etrangers (CTE)
répond à la pénurie en ressources humaines parties sur les frontières du
Nord-Est du pays. Mais les dispositions légales de création de ces compagnies
sont prises bien avant le mois de septembre. Dans un décret du 12 avril 1939,
Daladier oblige les étrangers bénéficiaires du droit d’asile à se conformer aux
exigences des lois sur le recrutement et l’organisation de la nation en temps
de guerre. Les réfugiés espagnols ont déjà reçu ce traitement particulier grâce
au décret
du 20 mars 1939, qui les soumet à la loi du 18 juillet 1938 relative à
l’organisation de la France en temps de guerre. Le décret étend cette loi aux
réfugiés espagnols. Il autorise la réquisition des réfugiés espagnols de sexe
masculin, âgés de plus de 18 ans et de moins de 60 ans.
Le droit d’asile est lui-même
restreint. Il subordonne son attribution à l’obligation pour un réfugié de fournir
un travail encadré par une organisation dirigée par le ministère de la Guerre.
Le refus de cette réquisition entraine la perte de la qualité de réfugié et
signifie l’expulsion hors de France.
Le décret du 27 mai 1939 précise les détails de la mise en œuvre des CTE. A travers lui, Daladier affirme sa volonté de régler le sort des internés dans les camps de concentration en déclarant vouloir « constituer, avec une partie des Espagnols qui se trouvent encore dans les camps du Sud-Ouest, un certain nombre de compagnies d’ouvriers de renforcement appelées à être utilisées dans les établissements constructeurs et poudreries ». Le 13 janvier 1940, il complète le processus par un autre décret qui stipule que : « [Les Espagnols] seront groupés en formations de prestataires dont l’organisation sera fixée par le ministre de la Défense nationale et de la Guerre » et « exceptionnellement [ils] pourront faire l’objet d’affectations individuelles ». Ils seront employés « à l’exécution de tous travaux nécessités par les besoins du département de la Défense Nationale ». En outre, ils « seront soumis aux règles de discipline générale en vigueur dans l’armée ». Constitués en groupes de prestataires militaires étrangers, ils sont désignés sous le vocable de Compagnies de Travailleurs Etrangers (CTE). Chaque CTE dispose d’un effectif moyen de 250 hommes sous la responsabilité d’officiers Français.
Les Espagnols dans l’armée française
Lorsque la France déclare la guerre à l’Allemagne, un certain nombre d’Espagnols, célibataires ou isolés familialement, se persuadent que cette guerre permet de poursuivre le combat contre le fascisme entamé en 1936, en Espagne. Autour de 6 000 franchissent alors le pas en s’engageant dans l’armée française. Cette dernière leur propose deux options :
· La Légion étrangère française ;
· Les régiments de marche de volontaires étrangers,
Les premiers, après avoir combattu jusqu’à l’effondrement de l’armée en juin 1940, partent pour l’Afrique du Nord quand Pétain signe l’armistice. Ils attendent le moment opportun pour rejoindre, à la première occasion, les Forces Françaises Libres de De Gaulle.
Les seconds sont affectés :
· Soit dans les unités envoyées en Norvège. Ceux qui échappent à la mort se retrouvent en Angleterre et intègrent les Forces Françaises Libres.
· Soit sur la Ligne Maginot.
De ce fait, ils sont astreints aux règlements en vigueur dans l’armée française. Lors de la débâcle de mai-juin 1940, lorsqu’ils sont capturés par les Allemands, ce statut leur laisse croire qu’ils vont être traités comme des prisonniers de guerre, au même titre que les prisonniers français. Mais ils déchantent très vite. Le gouvernement de Vichy ne les reconnait pas et les abandonne au bon vouloir des vainqueurs. Leur sort est tragiquement réglé grâce aux rapports étroits qu’entretiennent les nazis avec le régime franquiste.
Ramon Serrano Suñer, germanophile notoire, grand admirateur des raouts nazis et beau-frère du dictateur Franco, ne cache pas sa joie face à l'évolution que prend la guerre pour la cause allemande. Au cours de l'été 1940, Serrano Suñer commence à s'intéresser aux milliers d'Espagnols républicains exilés en France, désormais sous occupation allemande. En tant que ministre de l’Intérieur, il joue un rôle de premier plan dans la transformation du statut juridique des prisonniers républicains espagnols. Le refus qu’il oppose à la demande allemande de les renvoyer en Espagne a pour conséquence que ces Espagnols passent de prisonniers de guerre de l'armée allemande à celui, moins enviable, de prisonniers politiques apatrides de la Gestapo. Ils sont, alors, déportés des camps de détention des prisonniers de guerre (frontstalag) vers les camps de concentration nazis. Ils les considèrent comme des « rotspanienkämpfer » (« combattants rouges espagnols »). Ils sont traités comme des prisonniers qui doivent être esclavagisés jusqu’à leur anéantissement.
Les Espagnols après l’armistice
L’armistice du 22 juin 1940
conduit les Espagnols enrôlés dans les CTE à vivre des fortunes diverses. Dans
le chapitre précédent, nous avons vu comment ont été traités ceux qui, au
service direct de l’armée française, sont tombés aux mains des nazis, principalement
dans la souricière qu’était la Ligne Maginot. En ce qui concerne ceux qui se
trouvent dans des CTE éloignées des théâtres d’opérations militaires, leur
destinée est beaucoup plus diverse et imprécise au vu de la désorganisation
générale de la France. Certains sont renvoyés dans leur camp d’origine.
D’autres trouvent un emploi leur permettant d’échapper à l’univers concentrationnaire
des camps. Moins nombreux, mais déterminés, certains rentrent en clandestinité
et rejoignent les premiers groupes de résistance à l’occupation allemande.
Dès l’été 1940, à partir du moment où Pétain et ses affidés s’installent à Vichy, la situation des Républicains espagnols devient extrêmement compliquée. Les responsables politiques, identifiés par le régime franquiste sont pourchassés. Ceux qui ne peuvent pas fuir en Amérique latine ou en URSS, font l’objet de recherches par la police, la gendarmerie et la Gestapo, assistées par des policiers franquistes dirigés par Pedro Urraca Rendueles. Le cas le plus connu est celui de Lluis Companys, président de la Généralité de Catalogne, arrêté par Urraca avec l’aide de la Gestapo, le 13 août 1940 à la Baule, remis à Franco et fusillé le 15 octobre 1940.
Les Espagnols à Mauthausen
Mauthausen et Gusen sont considérés comme les camps de concentration ayant le taux de mortalité le plus élevé. Les prisonniers souffrent de malnutrition. Juste avant la libération du camp en 1945, la ration quotidienne d’un détenu ne dépasse pas le tiers des besoins d’un travailleur de force. Les baraquements sont surpeuplés et les coups des gardes sont le lot quotidien. A cela s’ajoute l’obligation de fournir un travail exténuant dans les carrières de granit dans des conditions climatiques extrêmes. La présence d’une centaine de médecins parmi les prisonniers n’est d’aucun secours. Sans médicaments, ni matériel médical, seuls les premiers secours peuvent être prodigués avec la mort au bout du parcours.
L’architecture national-socialiste est friande de granit pour parer ses monumentaux édifices. Elle trouve cette matière première au fond de la mine de granit de Mauthausen, au pied du terrible « escalier de la mort ». Les prisonniers doivent porter des blocs de pierre, grossièrement taillés et pesant souvent 50 kg, jusqu’au sommet des 186 marches de l'escalier. De nombreux prisonniers épuisés s'effondrent et entraînent la chute des compagnons d’infortune qui se trouvent derrière eux. Ceux qui sont trop faibles pour continuer à travailler et ceux qui sont à l’article de la mort sont gazés puis envoyés au four crématoire.
Le sadisme des SS n’a pas de limites. Ils peuvent battre à mort, tuer d’un coup de pistolet ou fusiller un homme pour des raisons les plus futiles ou par simple lubie.
Parfois, les SS conduisent des prisonniers le long d'une falaise appelée « mur des parachutistes ». Sous la menace d'une arme, chaque prisonnier a le choix d’être abattu ou de pousser dans le vide le prisonnier qui le précède.
Dans cette folie meurtrière, des médecins allemands, fanatisés, ne sont pas en reste. L’un d’eux, Aribet Heim, le « docteur la Mort » pratique, pendant sept semaines, des injections létales, directement dans le cœur des prisonniers, essentiellement juifs. Les Espagnols le surnomment « le banderillero ». Karl Gross, quant à lui, infecte des centaines de prisonniers avec le choléra et le typhus pour tester ses vaccins. Entre février 1942 et avril 1944, plus de 1 500 prisonniers succombent à la suite de ces traitements. D’autres expériences sont menées sur les détenus, comme la résistance au froid en les forçant à prendre des douches glacées et à rester dehors par temps glacial. Devant tant de barbarie, les prisonniers les plus désespérés se pendent ou se jettent sur les clôtures électrifiées.
Le photographe espagnol de Mauthausen
En 1936, âgé de 17 ans, le jeune républicain catalan, Francesc Boix i Campo, fils d’un anarchisant, fait des reportages pour la revue Juliol, des Jeunesses Socialistes Unifiées, proches du Parti Communiste Espagnol. Fin 1937, il rejoint les forces républicaines en Aragon. Au moment de la chute de la Catalogne, il passe la frontière en février 1939, avant d’être interné au camp de concentration du Vernet-d ’Ariège puis celui de Septfonds (Tarn-et-Garonne). En septembre 1939, il fait le choix de s’enrôler dans une CTE qui le mène en Lorraine, sur la Ligne Maginot. Fait prisonnier par les Allemands, il passe par un stalag en Allemagne avant de se retrouver au camp de concentration de Mauthausen, le 27 janvier 1941.
Les SS mettent à profit ses compétences de photographe en l’affectant au service d’identification des nouveaux détenus. Il est mis à contribution pour développer des négatifs destinés à la propagande nazie ainsi que des photos privées pour le compte des chefs SS : visites officielles de dignitaires, travail exténuant des déportés, exécutions sommaires…
Au début de 1943, les SS reçoivent l’ordre de détruire ces images devenues compromettantes. Avec l’aide d’autres Espagnols du camp, membres de l’organisation clandestine d’entraide, Boix réussit à dérober des milliers de photos avant leur destruction et à les mettre à l’abri grâce à la complicité d’une Autrichienne.
Lorsque les SS prennent la fuite en abandonnent le camp, Boix redevient reporter pour fixer sur la pellicule un témoignage pour l’Histoire. Le 5 mai 1945, les troupes américaines atteignent le camp, c’est la libération, trois jours avant la capitulation allemande. Certains de ses clichés servent de pièces d’accusation lors des procès de Nuremberg. Il est appelé à témoigner devant le tribunal par les accusateurs français car son travail constitue un regard nazi sur des déportés martyrisés et éclaire la logique et le fonctionnement du système concentrationnaire du IIIe Reich. Kaltenbrunner tente de discréditer les images en les qualifiant de montage. Mais la présentation des négatifs réfute ses arguments.

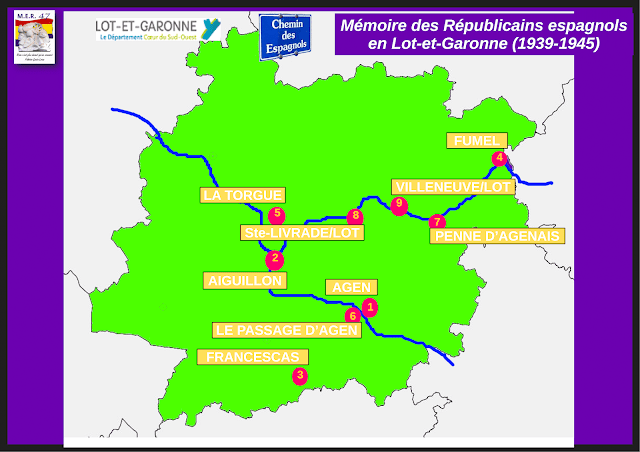
Commentaires
Enregistrer un commentaire