09-5 - Villeneuve - square Antonio Machado
Le poète engagé aux côtés de la République espagnole
Le poète et prosateur intimiste et idéaliste qu’Antonio Machado est au début de sa carrière littéraire, va lentement acquérir la conviction qu’un intellectuel ne peut pas vivre à l’écart du monde dans lequel il baigne. Ainsi, en 1938, il déclare : « De spectateur de la politique, je suis soudain devenu un acteur passionné ». Cette année-là marque la fin des illusions du camp républicain face à l’inexorable avancée du camp fasciste. Machado constate que la défaite est en grande partie due à l’invasion de sa patrie par des forces étrangères qui financent et arment les franquistes. Pour autant, il ne s’avoue pas vaincu et continue à être un phare dans la nuit qui s’annonce. C’est pour cette raison qu’il reste le symbole de la République éternelle. Les visites qui lui sont rendues quotidiennement, sur sa tombe à Collioure, en témoignent.
La formation du jeune Antonio Machado
Antonio Cipriano José María Machado Ruiz est né à Séville le 26 juillet 1875. Arrivé, avec sa famille, à Madrid en 1883, il fait une partie de ses études à l’Institution Libre d’Enseignement – ILE. Cette institution est créée en 1876, peu après la fin de la 1ère République espagnole et le retour des Bourbons. Fortement inspirée par les idées modernistes, elle refuse toute inféodation aux préceptes religieux. Nul doute que le jeune Machado a été marqué par cette expérience éducative.
Au cours d’une vie de bohème dans le Madrid lumineux des intellectuels et des politiques de la fin du XIXe siècle, il pratique plusieurs métiers. Attiré par le théâtre, il devient acteur. Il collabore à la rédaction d’un Dictionnaire d’idées similaires, dirigé par le lexicologue et ancien ministre républicain Eduardo Benot.
Il se rend à Paris en 1899. S’étant découvert un penchant littéraire lors de ses études à l’ILE, il le cultive au contact d’intellectuels contemporains lors de ce séjour. On peut citer, entre autres, Paul Fort et Oscar Wilde. La poésie de Paul Verlaine est, pour Machado, une découverte. De retour à Madrid, il multiplie les rencontres avec des intellectuels liés au mouvement Moderniste, tel Juan Ramon Jimenez.
Machado, le poète
La poésie devient, pour Antonio Machado, une vraie passion. Il commence par publier ses premiers travaux dans les journaux. Puis son premier livre de poésies parait en 1903, sous le titre Soledades. Il publie, en 1907, une version enrichie sous le titre Soledades. Galerías. Otros poemas où transpire l’influence du Paris symboliste et du Madrid bohème. La même année, il occupe un poste de professeur de Français à Soria, tout près de Madrid. Confronté à la dure réalité du plateau castillan, sa personnalité évolue. Le poète lyrique et mystérieux s’éloigne de ses rêveries symbolistes. Dans son nouveau livre, Campos de Castilla, le poète exprime ses jugements avec force. Il se manifeste sans fioritures, devient éthique et patriote.
A Soria, s’il est transformé par la Castille, il l’est autant par l’amour de sa vie, Leonor. Il l’épouse en 1909, malgré le fait qu’elle n’ait que 15 ans et que 19 ans les séparent. La brièveté de leur union, Leonor décédera de la tuberculose peu de temps après, est compensée par une entente parfaite entre les deux époux.
En 1910, le couple Machado est à Paris. Antonio en profite pour suivre les cours du philosophe Henri Bergson au Collège de France. A leur retour, la disparition de Leonor le plonge dans une profonde tristesse. Ne voulant pas rester à Soria, il accepte un poste de professeur de Français à Baeza, dans la province andalouse de Jaen. Dans cette ville, qualifiée de Salamanque andalouse, Machado découvre une réalité qui le choque. Si elle est la ville la plus riche de la province, à peine trente pour cent de ses habitants savent lire. La misère est à chaque coin de rue. Le poète se radicalise. Ses promenades solitaires dans les environs de la ville lui font redécouvrir les arts et traditions populaires. Cela se traduit dans son nouvel ouvrage, Nuevas canciones.
Pour échapper à l’ennui, il obtient en 1919, en candidat libre, le diplôme de professeur de philosophie, ce qui lui permet d’obtenir un poste à Ségovie. Auparavant, en 1916, Machado rencontre un jeune poète, avec qui il devient ami, Federico García Lorca. Pour Antonio Machado, Ségovie est la banlieue de Madrid. Chaque fin de semaine, le poète rejoint la capitale où il retrouve son frère Manuel et le bouillonnement politique et culturel madrilène. Le reste du temps, il ne se prive pas de participer à la vie sociale et culturelle ségovienne. En 1929, une lettre qu’il adresse à sa muse Guiomar révèle son admiration à l’encontre du philosophe Miguel de Unamuno : « Unamuno est un homme de vérité parmi les nombreux masqués qui s’agitent aujourd’hui. »
C’est ainsi que le 14 avril 1931, il est chargé de hisser le drapeau tricolore sur l’Hôtel de ville de Ségovie au son de la Marseillaise. Les républicains, pris de court par les événements n’ont pas eu le temps de se doter d’un hymne national. Le poète traduira cette émotion de la manière suivante :
“¡Aquellas horas, Dios mío, tejidas todas ellas con el más puro lino de la esperanza, cuando unos pocos viejos republicanos izamos la bandera tricolor en el Ayuntamiento de Segovia! (…) Con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, la primavera traía a nuestra república de la mano.”
« Ces heures, mon Dieu, toutes tissées du plus pur lin de l’espérance, quand nous, vieux républicains, avons hissé le drapeau tricolore sur l’hôtel de ville de Ségovie ! (…) Avec les premières feuilles des peupliers et les dernières fleurs des amandiers, le printemps prenait notre République par la main. »
En 1932, la République lui attribue un poste d’enseignant à Madrid, ce qui lui permet de retrouver sa famille. Sa production poétique diminue au profit d’articles en prose dans la presse. Parallèlement, il œuvre au sein des Missions Pédagogiques pour diffuser le théâtre espagnol au plus profond de la péninsule.
Ce qui aurait pu être une fin de carrière excitante pour un intellectuel comme Machado devient un véritable cauchemar. Malgré la victoire du Front Populaire en février 1936, à l’activisme ultra-violent des forces réactionnaires, la gauche, surtout extrême, répond par une violence similaire. C’est le prétexte tant attendu par les militaires félons, soutenus par l’Eglise catholique, les aristocrates et la bourgeoisie capitaliste, pour attaquer la République. Le coup d’Etat de juillet 1936 échoue mais les factieux, aidés financièrement et militairement par les dictatures européennes, Allemagne, Italie. Portugal…vont s’implanter durablement.
Pour les madrilènes, la situation de quasi siège leur
complique l’existence au quotidien. Aussi, la mise en lieu sûr de certains
intellectuels est organisée. C’est le cas pour Antonio Machado. Accompagné par
sa famille, il part pour Valence où il poursuit son travail d’écrivain engagé
aux côtés de la République. Inlassablement, il écrit des poèmes, des analyses,
des discours qui lui attirent la reconnaissance et le respect des démocrates
espagnols et internationaux.
Le 14 avril 1937, il publie un texte dans lequel il livre son analyse au sujet
des six années écoulées depuis le 14 avril 1931 et où transpire sa foi en la
République :
“Depuis ce jour – je ne sais pas si vécu ou rêvé – jusqu’à aujourd’hui, où nous vivons trop éveillés et pas du tout rêveurs, six années se sont écoulées pleines de réalités qui pourraient être dans toutes les mémoires. Pendant ces six années, les historiens du futur écriront plusieurs milliers de pages, dont certaines vaudront peut-être la peine d’être lues. En attendant, je les résumerais en quelques mots. Quelques honnêtes gens, arrivés au pouvoir sans l’avoir voulu, peut-être sans même l’avoir attendu, mais obéissant à la volonté progressiste de la nation, ont eu l’idée singulière et brillante de légiférer selon des normes strictement morales, de gouverner dans le sens essentiel de l’histoire, qui est celui de l’avenir. Pour ces hommes, les aspirations les plus justes et les plus légitimes du peuple étaient sacrées ; on ne pouvait pas gouverner contre eux, parce que les satisfaire était précisément la raison d’être la plus profonde de tout gouvernement ; et ces hommes, nullement révolutionnaires, pleins de respect, de modération et de tolérance, n’ont foulé aux pieds aucun droit ni abandonné aucun de leurs devoirs. Telle fut, à grands traits, la deuxième glorieuse République espagnole, qui se termina, à mon avis, par la dissolution des Cortes constituantes [avec la victoire de la droitière CEDA aux élections de 1933]. Mettons en exergue ce nom clairement représentatif : Manuel Azaña.
Puis vint l’époque de la laborieuse et persistante trahison à l’intérieur de la maison. Ces hommes, nobles, républicains et socialistes, avaient naïvement interrompu toute une tradition picaresque, et l’inertie sociale tendait à la restaurer. Ce furent plus de deux années tellement pauvres en héroïsme, engoncées dans la vie bourgeoise, et riches en sombres anecdotes. Un homme politique infâme, véritable monstre de bassesse, mélange de Judas Iscariote et de cheval de Troie, s’est chargé de vendre – littéralement et à bas prix – la République, en accueillant dans son insondable ventre les pires ennemis du peuple. C’est ce que les hommes d’alors appelaient : élargir la base de la République. Désignons un nom parmi les vils qui les représente tous : Alejandro Lerroux.
Mais la trahison échoua à l’intérieur de la maison, car le peuple éveillé et vigilant, l’avait dénoncé. Et l’actuelle République a émergé, la plus glorieuse des trois – disons-le aujourd’hui courageusement, car dans vingt ans les écoliers le diront en chœur – ; la troisième République espagnole a émergé avec la victoire dans les urnes du Front populaire. Les mêmes hommes de 1931 revinrent, obéissant au peuple, dont ils représentaient légitimement la volonté ; et de nouveau ils détenaient un mandat du peuple, qui n’était pas exactement la révolution sociale, mais le devoir incontournable de ne reculer devant aucun effort, aucun sacrifice, si la réaction vaincue tentait de nouvelles et désespérées trahisons. Puis surgit la rébellion des militaires, la trahison mûre et définitive qui couvait depuis des années. Ce fut l’un des événements les plus lâches de notre histoire. Les rebelles militaires ont retourné contre le peuple toutes les armes que le peuple avait mis entre leurs mains pour défendre la nation. Comme ils n’avaient pas de volontaires pour les manier, ils les ont achetés à la faim africaine. Ils ont payé avec de l’or, qui n’était pas le leur, toute une armée de mercenaires, et comme cela ne suffisait pas pour triompher d’un peuple presque sans défense, mais plein d’héroïsme et d’abnégation, ils ont ouvert nos ports et nos frontières aux volontés impérialistes de deux grandes puissances européennes. A quoi bon continuer ?… Ils ont vendu l’Espagne. Mais la force de la IIIe République tient toujours. Aujourd’hui, le peuple la défend contre les traîtres de l’intérieur et les envahisseurs de l’extérieur, car la République, qui a commencé comme une noble expérience espagnole, est aujourd’hui l’Espagne elle-même. Et c’est le nom de l’Espagne, sans adjectifs, qu’il faut soutenir en ce 14 avril 1937.”
Durant son exil valencien, il écrit l’un de ses poèmes les plus emblématiques, « Le crime était à Grenade » qui stigmatise l’assassinat de son ami Federico Garcia Lorca par les franquistes, en août 1936. L’avance des rebelles menace d’isolement Valence et oblige Machado, en mai 1938, à se replier sur la capitale catalane. Le 18 novembre 1938, il prononce une allocution radiophonique en forme d’appel au peuple :
“A tous les Espagnols : J’ai dit plus d’une fois, et
je ne me lasserai jamais de le répéter, que mon idéologie politique s’est
toujours limitée à n’accepter comme légitime que le gouvernement qui représente
la volonté du peuple, librement exprimée. Je dois ajouter que le mot « peuple »
n’a pas pour moi le sens de classe : tous les Espagnols font partie du peuple
espagnol. C’est pourquoi j’ai toujours été aux côtés de la République espagnole, à l’avènement de
laquelle j’ai travaillé dans la mesure modeste de mes forces et dans les voies
que je considérais légales. Lorsque la République s’est établie en Espagne,
comme expression sans équivoque de la volonté politique de notre peuple, je
l’ai accueillie avec joie et je me suis préparé à la servir, sans en attendre
aucun avantage matériel. Si elle était survenue à la suite d’un coup de force,
comme une imposition par la ruse ou la violence, je me serais toujours opposé à
elle. Je sais très bien qu’au sein d’une République il y a des problèmes bien
plus profonds que le strictement politique – ils sont de nature économique,
sociale, religieuse, culturelle, en somme – et que, au sein de cette République,
il y a des idéologies non seulement diverses, mais aussi contradictoires. Mais
aussi profonde et acharnée que soit la lutte, la République conserve sa
légitimité tant que la volonté du peuple, librement exprimée, ne la condamne
pas. Pour cette raison, lorsqu’un groupe de militaires retourna, contre le
gouvernement légitime de la République, les armes qu’il avait reçues de lui
pour le défendre d’agressions injustes, j’étais, sans hésitation, aux côtés de
ce gouvernement désarmé. Sans hésitation, dis-je, et aussi sans la moindre
vantardise ; parce qu’il croyait remplir un devoir strict. Les professionnels
de l’armée n’étaient plus l’armée de l’Espagne ; L’armée de l’Espagne était
alors, pour moi, celle que le peuple avait à improviser avec le meilleur de ses
enfants ; une armée si faible et insuffisamment armée au dehors, aussi forte et
surabondamment pourvue de raison et d’énergie morale, au dedans. Improvisée,
dis-je, avec le meilleur de ses fils, et je n’hésite pas à ajouter : avec un
petit groupe de volontaires, dans le sens noble du terme, d’hommes dévoués et
généreux qui sont venus en Espagne, sans la moindre ambition matérielle, verser
leur sang pour la défense d’une juste cause.
Avec tout cela, et convaincu de l’aveuglement, des erreurs, de l’injustice
de nos adversaires, dont je ne doutai pas un instant de la nature factieuse,
j’avoue que je ne pourrai jamais les détester ; avec toutes leurs erreurs, avec
tous leurs péchés, ils étaient espagnols ; et le lien fraternel, profondément
fraternel de la patrie commune, ne pouvait être rompu même par la guerre civile
la plus amère.
Mais est intervenu la monstrueuse invasion étrangère. De manière subreptice et lâche, elle a pris forme et réalité indéniable au fil du temps. Deux peuples étrangers étaient entrés en Espagne pour disposer de son destin futur et effacer, par la force et la calomnie, son histoire passée. Dans la transe tragique et décisive que nous vivons aujourd’hui, il ne peut y avoir aucun doute ni hésitation pour un Espagnol. Il ne lui est plus permis de choisir un camp ou un drapeau : il doit nécessairement être avec l’Espagne et contre les envahisseurs. Laissons de côté la part de culpabilité que des Espagnols ont pu avoir dans l’invasion de notre pays. Si ce péché existe, quelqu’un l’a commis consciemment, il est d’une telle nature qu’il échappe au pouvoir de sanction de tout tribunal humain.
Notez également que je n’ai même pas parlé de fascisme ou de marxisme. Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un en Espagne qui ait combattu plus que moi l’idéologie fasciste. J’ai pourtant toujours cru que, d’un point de vue théorique, il était possible d’être fasciste sans cesser d’être espagnol. Mais j’ai toujours affirmé qu’on ne peut pas être espagnol et livrer le territoire et les destinées de l’Espagne à la cupidité impérialiste du fasciste italien ou du raciste allemand. Je ne crois pas que quiconque, aujourd’hui, en Espagne, puisse honnêtement prétendre que cela soit possible.
[…]
On nous a calomniés, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Espagne, en disant que nous servons aussi une cause étrangère ; que nous travaillons pour le compte de la Russie. L’insulte est doublement perfide, mais si grossière, qu’elle n’a pas réussi à tromper quelqu’un d’autre que parfaitement imbécile. Car tout le monde sait (en a marre de savoir) que la Russie, ce peuple admirable, qui a renoncé à son empire pour libérer ses peuples, n’a jamais attenté à la liberté des étrangers et qu’elle n’a jamais eu la moindre ambition territoriale en Espagne. Tout le monde le sait, même si beaucoup feignent de l’ignorer.
Le jour est venu, hommes d’Espagne, de toute l’Espagne — je veux dire de tous les peuples hispaniques dont le territoire est envahi — où nous devons reconnaître cette dure vérité : notre devoir le plus impérieux est de lutter pour notre indépendance terriblement menacée. L’Espagne est forte, beaucoup plus forte que nos ennemis ne le pensent, parce que, comme je l’ai dit un jour, et cela ne me dérange pas de le répéter. L’Espagne n’est pas une invention de la diplomatie étrangère ou celle qui résulte de traités de paix plus ou moins ineptes. Elle a des siècles de vie propre, parfaitement définie par sa race, sa langue, sa géographie, son histoire et sa contribution à la culture universelle. Ne doutez pas un seul instant que celui qui refuse de défendre sa patrie contre l’invasion étrangère la trahit.
Le gouvernement de notre République, dans l’exercice incontestable du droit, et dans l’accomplissement de son plus haut devoir, a formulé dans le document du docteur Negrín, connu de tous, les grandes lignes permettant la fin de la guerre pour toute l’Espagne. Rien en elles n’est préjugé ; rien n’implique la coercition ou la menace. Tout en elles signifie attention et respect pour toutes les bonnes volontés de l’Espagne. Réfléchissez bien. Et écoutez la voix de votre conscience. Elle vous indiquera le seul chemin pour être Espagnol.”
Les derniers jours de janvier 1939 voient la chute de Barcelone. Le 22 janvier, un jour avant la perte de la ville, Antonio Machado, sa famille et quelques autres intellectuels se joignent à l’interminable colonne de Républicains Espagnols, hommes, femmes, enfants, chassés de leur patrie par les avions allemands et les troupes franquistes. C’est la Retirada où la retraite en français. Après une dernière nuit en terre espagnole, le groupe fait les derniers pas vers l’exil. Cinq-cents mètres avant la frontière, ils doivent abandonner les voitures, coincées dans le gigantesque embouteillage, ainsi que leurs bagages. Ils suivent à pied une longue pente, sous la pluie et le froid du soir, pour échouer au poste des douanes françaises. Grâce aux efforts de l’un des membres du groupe, ils montent à bord de voitures qui les conduisent à la gare de Cerbère. Là, ils passent la nuit dans un wagon abandonné sur une voie de garage. Le lendemain matin, ils voyagent en train jusqu’à Collioure, où ils trouvent refuge dans l’après-midi du 28 janvier, à l’hôtel Bougnol-Quintana. Puis, ils attendent une aide qui n’arrivera pas à temps.
Antonio Machado meurt le 22 février 1939, malade et complètement épuisé. Depuis, il repose au cimetière de Collioure. Sa tombe est, aujourd’hui encore, un lieu où se rendent de nombreux visiteurs, isolés ou en groupe, venus lui rendre hommage depuis les deux côtés de la frontière et d’ailleurs.
DIAS AZULES Y SOL DE MI INFANCIA – ANTONIO MACHADO
Estos días azules y este sol de la infancia
son languidez y añoranza en mis ojos,
ahora los días se enturbian
en mi memoria cansada.
Estos días azules y este sol de la infancia
ya son “ésos” que sólo permanecen vivos
como ecos en mi permanente recuerdo.
Hoy, mi torpe pulso quiere escribir al pasado
y acercarlo al presente
para empaparme de colores vivos,
del sol brillante, juguetón, amoroso,
que maquilla de rojo pasión el horizonte
e incendia las vedijas.
Ese sol de la infancia,
el que llenaba los patios blancos de Sevilla,
fue el mismo que el de mi juventud,
que amarilleaba las espigas maduras,
más si cabe, y las doraba.
Antes las irguió, cuando verdes,
como lanzas hacia el cielo, altivas,
manifestándose sólo en posición reverente
cuando eran mecidas por el céfiro indolente.
Y es que el sol de mi infancia
no se fatiga nunca:
es el mismo que sigue dando brillo
a los lingotes de oro de paja
en los vastos campos de Castilla.
¡Ay sol y Duero!, ¡Duero y sol de mis amores!
¡Cómo los rayos pintan de color tus aguas
formando tornasoles en la superficie,
grácil, suave y ondulada.
Tus aguas parecían melena suelta de doncella
de pelo ondulado e irisado,
o el plumaje del cuello de torcaces y arrendajos.
Hermosura plena.
Hermosura nacarada en la piel del agua
que mece tu corriente serena.
Hoy mi vista cansada recorre en la memoria los senderos,
las curvas de ballesta del Duero,
los pájaros canoros en tus orillas,
orquesta de violines, flautas y liras,
que saltan de retamas y majuelos
salpicando el rostro del firmamento
pífanos que acompañan tu rumor casi silencioso.
Pero a mi memoria no sólo llega el Duero,
recuerdo las calles de Soria, los balcones de flores,
los trinos de las oscuras golondrinas,
quizás venidas del sur, las de Bécquer,
los campos salpicados de amapolas,
repletas de sangre sus corolas,
el zureo de palomas, los maullidos de gatos en celo,
el zumbido de las moscas, inevitables golosas,…
Y es que todo …todo bulle en mi efervescente recuerdo.
¡Todo lo de mi Soria querida!
Esos días azules me acercan
a mi primer amor: mi dulce y joven Leonor.
Mujer que me hiciste ver
todavía más azules, los días azules.

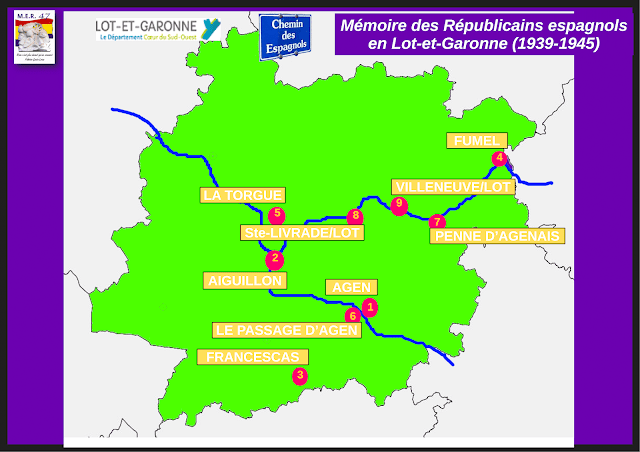
Commentaires
Enregistrer un commentaire